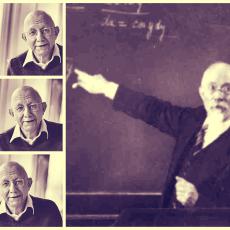« Piano piano », les 30 000 m2 de l’usine Maflow, désertée fin 2012, ont repris vie. L’histoire de cette fabrique de pièces automobiles de la banlieue de Milan aurait pourtant pu se terminer comme beaucoup d’autres. Le processus est déjà vu maintes fois. Une usine mise en faillite malgré une activité prospère. Le rachat - en liquidation judiciaire - par un groupe qui lorgne sur les machines et les brevets. Puis la délocalisation des machines vers la Pologne, deux ans plus tard. Mais à la Maflow un nouveau chapitre est en train de s’écrire. Les trois ans de lutte et la rencontre avec des militants politiques ont rendu possible l’occupation de l’immense usine, sa remise sur pied après le pillage de son réseau électrique, et la relance de petites activités.
Un an après le lancement du projet « Ri-maflow », fondé sur le principe du recyclage, 23 personnes y travaillent, dont une moitié d’anciens ouvriers de l’usine. Le week-end, un marché aux puces fait vivre le lieu et ramène des clients devant un petit bar récupéré dans un hôpital de Milan. Des anciens de l’usine ont développé un groupe d’achat équitable de produits agricoles de la plaine du Pô. Un studio de musique a pris ses quartiers dans la salle des tests des composants automobiles. À côté, un atelier de réparation de vélos, une petite production de liqueur de citron Limoncello, une salle de concert et un atelier d’artistes. De quoi faire vivre les lieux et tenter de constituer un capital pour relancer une activité de recyclage de matériel informatique et domestique, qui elle aussi a démarré sur une partie des locaux.
Recyclage, commerce équitable et discothèqueHors des heures du marché, l’immense bâtisse en tôle s’anime des allers-retours de la poignée de travailleurs. Le soir, après quelques verres de Limoncello, Elvio pousse les watts et allume les feux d’une petite discothèque installée dans un hall qui sert de salle de réunion. Une joyeuse bande de potes. Même si Rimaflow, « ce n’est pas facile », confient-ils de concert. « En Italie il n’y a pas d’usines occupées. Nous sommes isolés. Alors pour le moment, nous essayons juste de résister », raconte Antonio Galliazzo, qui travaille à l’accueil, à la commission culturelle et sur le site internet de Rimaflow. « D’ailleurs nous avons trinqué au 72ème jour d’occupation, s’amuse Gigi Malabarba, un des pères du projet Rimaflow. Nous avions tenu un jour de plus que la commune de Paris ! »
Pour le moment, les ouvriers se payent environ 400 euros par mois pour une quarantaine d’heures de travail par semaine. Un pécule que beaucoup complètent par le chômage (environ 60 % de leur ancien salaire), la retraite ou des petits boulots. « Notre activité est encore celle d’une association », explique Hicham M Sabhia, qui organise le marché derrière un imposant bureau en bois, récupéré lui aussi. Une association qui ne bénéficie d’aucun soutien des pouvoirs publics. L’équipe sortante à la mairie de Trezzano a d’ailleurs implosé en mai 2013 dans une affaire de corruption, créant un vide politique dans la ville où siège l’usine.
Syndrome de Stockholm ouvrierRimaflow, c’est aussi le pari d’une organisation en autogestion. « Il ne faudrait pas que cela devienne une exploitation des travailleurs par les travailleurs », plaisante Luca Federici, ouvrier de 34 ans et militant du réseau Communia, qui s’agite au quatre coins de l’usine. « C’est un effort permanent, nous devons constamment nous entendre et confronter les points de vue », raconte Massimo Bollini, ancien cariste de la Maflow engagé dans le projet. « Ce n’est pas évident à faire fonctionner, car la plupart des ouvriers ne sont pas politisés », ajoute Hicham M Sabhia. L’essence de Rimaflow, c’est l’impossibilité de retrouver un travail, dans une région sinistrée par les fermetures d’usines en cascades. L’idéal politique est moins unanimement partagé.
Depuis deux mois environ, l’atelier de recyclage connaît ainsi une baisse de régime. « Nous n’arrivons pas à créer un groupe stable de 5 personnes, raconte Luca Federici. C’est une organisation du travail très nouvelle pour certains, après vingt ans passés à sa place sur la chaîne de production, il est difficile de fonctionner en autogestion. Il y avait pour certains une relation forte avec la machine. Un syndrome de Stockholm. » Malgré tout Rimaflow prend racine. Le marché compte 80 exposants après six mois d’existence et l’usine tisse sa toile avec un réseau d’artistes et d’associations. Le tout reste illégal, mais déjà légitime aux yeux du propriétaire des lieux, qui accepte pour le moment de fermer les yeux. Il faut dire que la banque Unicredit serait incapable de trouver preneur pour un tel espace, alors que des dizaines d’usines vides végètent alentour. Les Rimaflow entretiennent les lieux, payent leurs charges et promettent de verser un loyer dès qu’ils en auront les moyens. L’usine est devenue un lieu de vie et se voit demain en « citadelle de l’autre économie ».
Dans les prochains mois, beaucoup d’ex ouvriers de Maflow perdront leurs allocations chômage. L’enjeu pécuniaire deviendra alors plus pressant à Rimaflow et avec lui, celui de l’avenir du projet. « Nous essayons d’apporter notre part à un changement global, mais il y a ce problème très concret, résume Antonio Galliazzo. Sans salaire, il n’y a pas d’idéal ».
« Ici, je me sens à la maison. » 
Elle fait partie de ceux qui connaissent le moindre recoin de cette usine. Mariarosa a travaillé à la Maflow pendant 22 ans. Qualifiée « Ouvrière de troisième niveau », elle a en fait touché à presque tous les postes de travail. La majeure partie du temps, elle travaillait dans la « piscine », à tester les tuyaux automobiles dans des bassins. « Ici, on fabriquait 3 000 tuyaux par jour », se rappelle-t-elle. Une entreprise qui carbure à plein régime. Elle a été d’autant plus surprise quand en 2009, le patron annonce que l’usine est en faillite.
A 48 ans, Mariarosa n’a pas voulu chercher du travail ailleurs. Elle a tout de suite adhéré au projet Rimaflow. « Je voulais essayer ce travail sans patron en autogestion », assure cette mère de deux filles. Une décision qui n’a pas fait l’unanimité dans son entourage. « Mon mari ne comprenait pas que je passe autant de temps ici plutôt qu’à chercher du travail. Il y avait la lutte pour le travail ici, mais aussi la lutte à la maison », plaisante t-elle. Aujourd’hui, elle ne se voit pas ailleurs. « Ici, je me sens à la maison. »
D’Alfa Romeo à Refondation communiste 
Le plus clair de sa vie professionnelle, Gigi Malabarba l’a passé à construire des portes arrière droite sur une chaîne de production. Entré à l’usine Alfa Romeo de la banlieue de Milan dans les années 1970, il s’est instantanément syndiqué. « À l’époque, la plupart des ouvriers étaient politisés », se souvient le sexagénaire, aujourd’hui retraité. Il y est resté trente-cinq ans et a milité activement pour repousser la fermeture annoncée de l’usine. Elle employait 23 000 personnes. Dix ans de lutte qui l’on conduit jusqu’au Sénat, où il est élu de 2001 à 2006 et préside le groupe Refondation communiste.
Cofondateur en 2013 du réseau Communia, groupe d’expérimentation sociale, c’est une des têtes pensantes du projet Rimaflow. Il le replace dans l’histoire récente des mouvements sociaux, avec un enjeu : rester concret. « La situation actuelle ne peut pas être pensée avec les réponses du passé. Les printemps arabes, les Indignés, Occupy wall street… Les gens aspirent aujourd’hui à s’occuper eux-mêmes des débouchés politiques de leurs luttes. Nous devons repenser le syndicalisme et poser le problème des exigences immédiates. »
« Je suis optimiste » 
Depuis les magasins de l’usine Maflow, où il gérait les stocks, Massimo Bollini n’a jamais soupçonné que son usine ferme un jour. « Je n’étais pas le seul à être surpris de la fermeture. Il y avait beaucoup de travail. L’usine fonctionnait en 3-8 et employait jusqu’à 900 personnes au plus fort de la production. » L’explication est ailleurs, raconte l’ancien cariste qui figurait parmi les premiers ouvriers mobilisés contre la délocalisation : « Pour travailler avec BMW, il faut un certificat de qualité. Le repreneur ne l’avait pas pour produire en Pologne. Son rachat de la Maflow était stratégique. Il a mené les choses très intelligemment. »
À aujourd’hui 49 ans dont vingt à travailler à la Maflow, impossible pour lui de retrouver un travail, il s’engage donc à Rimaflow où il s’occupe du marché des producteurs, de la buvette et continue de conduire le « Fenwick ». « Rimaflow, c’est quelque chose que nous avons créé nous-mêmes, sourit-il. L’ambiance est sympathique, on est loin du management avec un patron, où chaque ouvrier n’est qu’un numéro. Ce n’est pas facile, mais je suis optimiste quant à notre avenir. »
De la révolution tunisienne à Rimaflow 
Hicham M Sabhia est un jeune homme au regard profond. Militant trotskiste tunisien de 26 ans, il a dû fuir en juillet la répression d’Ennahda après plusieurs arrestations. Son exil, organisé pour le rendez-vous annuel de la 4ème internationale, le mène en Grèce, puis à Rome et enfin Milan, il y a huit mois. Une place lui est faite pour dormir et travailler à Rimaflow. Il vit là, suspendu aux nouvelles de sa famille et de ses « camarades » en Tunisie. « J’ai laissé toute une vie là-bas, soupire cet ancien guide touristique, polyglotte et féru d’histoire. Je suis ici pour prendre de l’expérience. Mais je me vois rentrer. »
Son père travaillait dans les mines de phosphate pour 500 dinars par mois (250 euros), ses 4 frères et sœurs sont tous professeurs. Il s’est forgé une solide pensée politique, qui dissone parfois avec la vision des ex-ouvriers de la Maflow : « J’ai un profond respect pour eux, recadre-t-il pourtant. Rimaflow est une mosaïque, chaque pièce est importante pour former un tout harmonieux ».